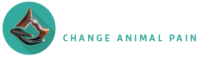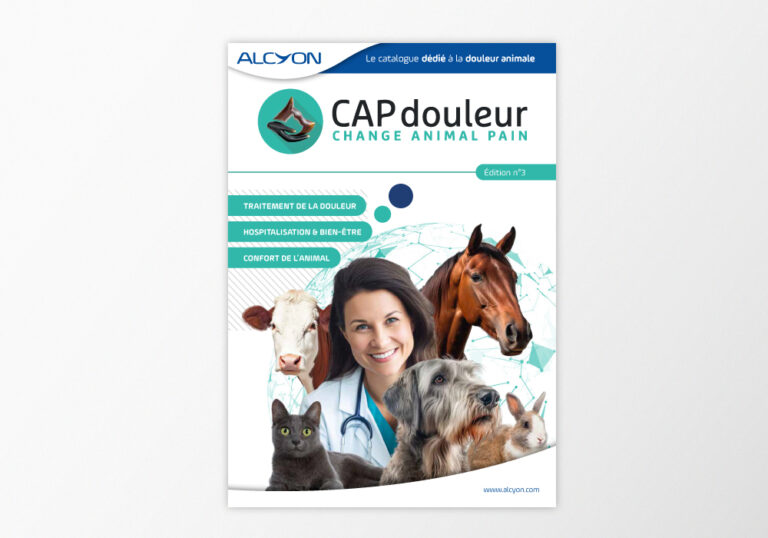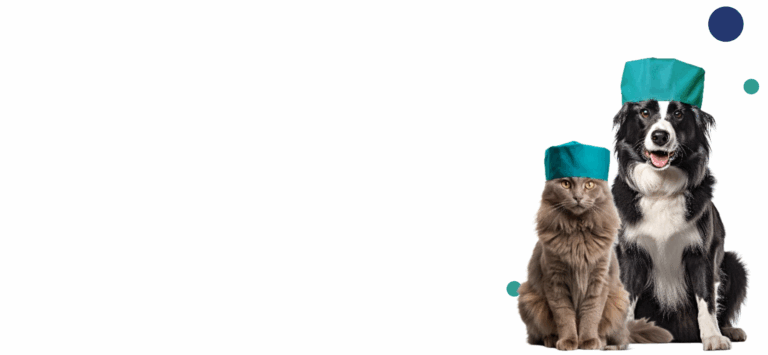Les Conseils de
Giacomo Giannettoni
Catalogue CAPdouleur - Alcyon 2025
Dr Giacomo Giannettoni, DMV, Post-résident anesthésiste centre hospitalier vétérinaire ADVETIA. Catalogue CAPdouleur-Alcyon juillet 2025
Chirurgie du genou
L’anesthésie locorégionale du genou implique le bloc des afférences sensitives des nerfs fémoral et sciatique. Le nerf fémoral comprend une branche motrice, assurant l’innervation du muscle quadriceps fémoral, ainsi qu’une branche sensitive, le nerf saphène, qui innerve la face crâniale et médiale de l’articulation du genou. Le nerf sciatique est constitué des nerfs fibulaires commun (ou péronier) et tibial, lesquels assurent l’innervation motrice du segment distal du membre, en contrôlant les mouvements d’extension et de flexion, ainsi que l’innervation sensitive des régions latérale et caudale du genou, ainsi que de la portion distale de la jambe. Parmi les techniques décrites pour la réalisation de l’anesthésie locorégionale, les approches par neurostimulation et échoguidage apparaissent comme les plus appropriées et précises dans ce contexte.
Bloc par neurostimulation.
Pour le bloc par neurostimulation du nerf fémoral, le point de repère principal est l’artère fémorale, située au niveau du triangle fémoral, dans la région proximale et médiale de la cuisse. Le nerf fémoral se trouve en position crâniale par rapport à l’artère ; ainsi, l’insertion de l’aiguille connectée au neurostimulateur dans cette zone permettra d’obtenir une extension du genou, due à la contraction du muscle quadriceps. Pour le nerf sciatique, les points de repère sont le grand trochanter et la tubérosité ischiatique. L’aiguille devra être insérée à midistance entre ces deux repères. Une fois à proximité du nerf, la stimulation provoquera une extension ou une flexion du tarse. La stimulation initiale sera réglée à 1 mA, à une fréquence de 1 Hz pour une durée d’impulsion de 100 millisecondes ; cette intensité sera progressivement réduite à mesure que l’aiguille s’approche du nerf, jusqu’à atteindre une intensité de 0,4 mA, tout en conservant une réponse motrice visible. Cette réponse indique une proximité optimale du nerf, estimée entre 2 et 3 mm.
Bloc échoguidé
Pour le bloc du nerf fémoral, une sonde linéaire est placée au niveau du triangle fémoral, perpendiculairement au trajet du nerf et de l’artère. Une fois les structures identifiées (nerf fémoral, artère fémorale, muscle quadriceps), l’aiguille est avancée selon une direction crânio-caudale, à travers le muscle quadriceps. Pour le bloc du nerf sciatique, la sonde linéaire est positionnée distalement par rapport au grand trochanter et à la tubérosité ischiatique, perpendiculairement à l’axe du nerf sciatique. L’aiguille est alors introduite selon une direction caudo-crâniale à travers le muscle triceps fémoral. Le volume d’anesthésique local (principalement de la ropivacaïne) recommandé est de 0,1 ml/kg pour chacun des deux blocs à réaliser.
Blocs de la tête
Particulièrement utiles en cas de chirurgie dentaire ou maxillo-faciale, les techniques d’anesthésie locorégionale de la tête sont simples à réaliser et nécessitent peu de matériel (aiguille hypodermique, seringue et anesthésique local). L’innervation de la cavité buccale est symétrique de droite à gauche : l’arcade maxillaire est innervée par le nerf maxillaire et sa branche la plus rostrale, le nerf infra-orbitaire ; l’arcade mandibulaire est innervée par le nerf mandibulaire et sa branche la plus rostrale, le nerf mentonnier. Pour obtenir une désensibilisation complète de la cavité buccale, il est nécessaire de réaliser les blocs des deux nerfs maxillaires et des deux nerfs mandibulaires. Si seule la portion rostrale est concernée, les blocs des nerfs infra-orbitaire et mentonnier seront suffisants. Un volume de ropivacaïne de 0,2 à 0,3 ml par point d’injection est recommandé pour une désensibilisation efficace.
Anesthésie Neuraxiale
Cette branche de l’anesthésie locorégionale comprend deux techniques : l’épidurale et la rachianesthésie (ou anesthésie spinale). Les deux visent à désensibiliser une portion plus ou moins étendue du rachis, permettant ainsi un bloc sensoriel et moteur bilatéral s’étendant de l’origine nerveuse jusqu’à la périphérie.
La moelle épinière est entourée par les méninges (dure-mère, arachnoïde, pie-mère) ; selon l’endroit où l’anesthésique local est injecté, on distingue les deux techniques : dans l’épidurale, l’anesthésique est injecté dans l’espace entourant la dure-mère — un espace théoriquement vide, occupé uniquement par des trabéculations fibreuses et du tissu adipeux. Si l’anesthésique est injecté entre l’arachnoïde et la pie-mère, on parle alors de rachianesthésie ; cet espace contient déjà le liquide cérébrospinal, ce qui signifie que la diffusion de la solution dépendra du rapport entre les deux fluides. Les techniques rachidienne et épidurale peuvent toutes deux être réalisées au niveau de l’espace intervertébral L7-S1. Toutefois, chez le chat notamment, des études anatomiques montrent que la moelle épinière peut s’étendre jusqu’à L7 voire S1, c’est pourquoi il est recommandé d’effectuer l’épidurale au niveau sacro-coccygien afin d’éviter tout risque de lésion médullaire. Pour les techniques neuraxiales, on peut utiliser un mélange d’anesthésique local et d’opioïde : pour un volume total de 0,2 ml/ kg, on administre 0,5 mg/kg de ropivacaïne, 0,1 mg/kg de morphine, et l’on complète le volume avec du sérum physiologique stérile. Les complications potentielles de ces techniques incluent l’hypotension, l’hémorragie et la rétention urinaire.