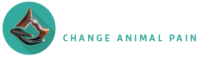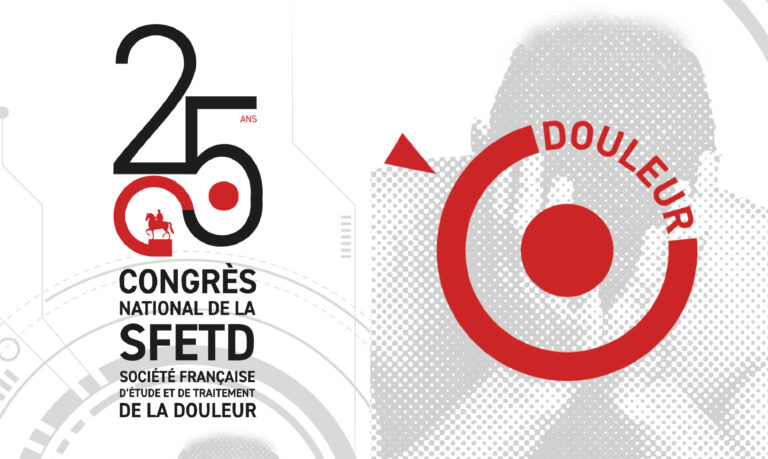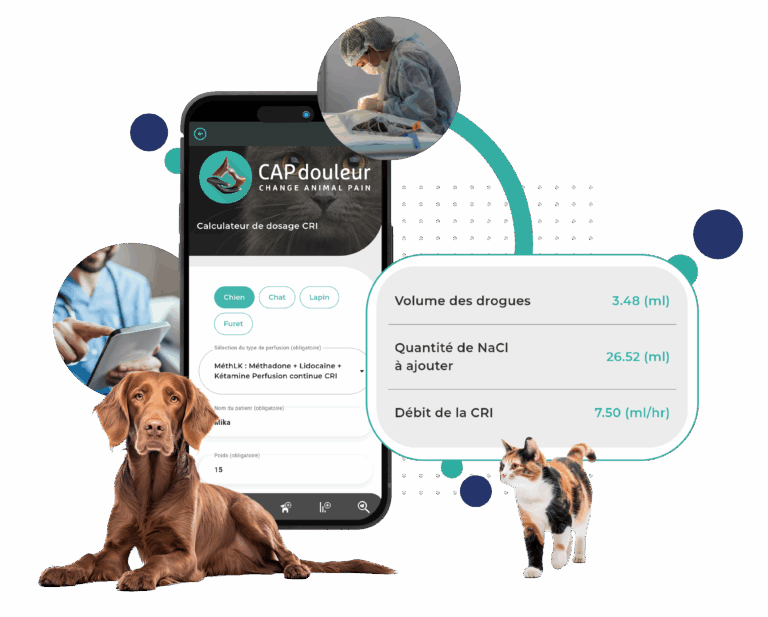Quand l’erreur blesse
aussi le soignant

Leïla ASSAGHIR – Vétérinaire et consultante en sécurité des soins chez Eclaireur
Article réalisé pour Vetoptim et CAPdouleur.
Introduction
Encore étudiante, je me souviens de cette garde aux urgences où une dame est arrivée avec son chat en fin de vie. Suivi depuis longtemps pour une insuffisance rénale, il ne répondait plus au traitement, ne mangeait plus et peinait même à rester debout. La décision d’euthanasie avait déjà été envisagée avec son vétérinaire traitant ; ce soir-là, il était temps de mettre fin à ses souffrances.
La dame, en pleurs, m’a écoutée expliquer la procédure. Comme le voulait le protocole de l’école, nous avons posé un cathéter. Mais le chat, malgré son état, s’est débattu. La contention était difficile, et le cathéter a été mal placé. Le produit d’euthanasie a été injecté en péri-veineux et l’animal a souffert. Je garde encore en mémoire la plainte qu’il a émis à ce moment-là. Finalement, nous avons réussi à poser un cathéter sur l’autre patte, et le chat est parti paisiblement.
Cette erreur n’a pas changé l’issue, le chat devait mourir ce soir-là. Mais elle a ajouté de la douleur dans un moment déjà si sensible. Et pour moi, qui réalisais quasiment seule ma première euthanasie, cela a été un choc profond. Je me suis sentie nulle. J’ai culpabilisé : c’était de ma faute si le chat avait souffert, c’était de ma faute si la propriétaire allait garder comme dernier souvenir de lui cette image de douleur. Et plus encore, j’ai eu honte. Honte de ne pas avoir su poser ce cathéter, honte de ne pas avoir été à la hauteur. Au point de garder le silence, sans en parler à mes camarades.
La culpabilité et la honte, émotions typiques après une erreur
Ce témoignage illustre ce que ressentent de nombreux soignants après une erreur. Que l’on soit jeune diplômé ou vétérinaire expérimenté, auxiliaire débutant ou chevronné, nous avons tous commis un jour une erreur qui nous a marqués : une anesthésie qui se complique, une injection mal faite, un diagnostic raté, un animal qu’on n’a pas pu sauver…
La culpabilité s’accompagne alors de la scène qui se répète en boucle dans notre tête, avec des scénarios que l’on essaie de changer : » et si… et si j’avais fait autrement ? ». La honte surgit aussi, avec la peur du regard des autres et l’impression d’être incompétent.
Ces émotions touchent à la fois notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Dans notre pratique, elles se traduisent par la peur de refaire le même geste, une perte de confiance en soi, un état d’hypervigilance… Mais elles débordent aussi en dehors du travail : cauchemars où l’on revit la scène, images qui reviennent quand on ferme les yeux, troubles du sommeil, sentiment de vide à la fin de la journée.
Et nous ne sommes pas rares à vivre cela. Une enquête menée auprès de 300 vétérinaires et ASV en anesthésie a montré que 70 % avaient connu un événement indésirable récent. Beaucoup décrivaient les mêmes réactions : crainte permanente de l’erreur, remise en question profonde, parfois jusqu’à envisager de quitter la profession.
La notion de seconde victime
Ressentir de la culpabilité après une erreur est normal, ressentir de la honte peut l’être aussi. Nos émotions traduisent l’importance que nous portons à nos patients et à notre pratique. Elles font partie d’un continuum humain. Ce qui devient problématique, c’est quand ces émotions durent, s’intensifient ou s’immiscent dans notre quotidien. C’est alors qu’elles risquent de devenir envahissantes, voire déstabilisantes sur le plan professionnel et personnel.
En médecine humaine, on désigne depuis les années 2000 ce vécu de l’erreur médicale comme le syndrome de seconde victime : « un soignant impliqué et traumatisé par un événement imprévu ou une erreur médicale, qui se sent personnellement responsable et remet en question ses compétences ». Cette notion s’applique aussi à notre métier. Dans le monde vétérinaire, les erreurs existent, et nous en souffrons. Il y certes l’animal et sa famille, les premières victimes évidentes. Mais il ne faut pas oublier le vétérinaire et l’ASV, qui portent aussi une souffrance réelle.
Les clés pour avancer
Après une erreur, le plus difficile est souvent d’accepter d’avoir soi-même besoin de soin. Pourtant, se reconnaître comme seconde victime est la première étape pour aller de l’avant. C’est s’autoriser à ressentir, à souffrir, à être bouleversé, sans y voir un signe de faiblesse mais comme la conséquence humaine d’un métier où l’on porte chaque jour la vie entre ses mains.
Prendre du recul est ensuite essentiel. Parfois, cela passe par quelques minutes à l’écart, parfois par quelques jours de repos. S’accorder ce temps, c’est se donner la possibilité de digérer l’événement et d’éviter qu’il ne reste enfoui comme une blessure prête à resurgir. Pour certains, cela peut être une promenade, un moment de silence, ou même une pause loin de la clinique.
En parler peut sembler difficile, mais c’est souvent libérateur. Partager ce que l’on ressent avec ses collègues ou ses pairs permet de découvrir qu’on n’est pas seul. Déverser son sac auprès d’une oreille empathique, qui connaît le métier et a peut-être vécu des situations proches, n’est pas la même chose que de se confier à sa famille ou à des amis : aussi présents soient-ils, ils ne peuvent pas toujours comprendre ce que l’on vit. Dans certaines équipes, la confiance manque pour se livrer sans crainte ; il est alors possible de trouver du soutien auprès de structures dédiées comme Vétos Entraide ou l’association Soins aux Professionnels de Santé, qui offrent un espace d’écoute confidentiel.
Et quand la souffrance devient trop lourde (insomnies, cauchemars, anxiété persistante, perte de confiance…), il est important de chercher une aide professionnelle. Chacun n’a pas la même capacité de résilience, chacun traverse ses propres moments de fragilité. Se faire accompagner n’enlève rien à sa compétence, c’est au contraire un pas vers la guérison et vers une pratique plus sereine.
Conclusion
Faire une erreur, c’est aussi faire l’expérience de nos limites humaines. Cela fait mal et cela bouscule. Mais reconnaître nos émotions et accepter d’être, nous aussi, des secondes victimes, c’est déjà commencer à transformer cette souffrance en résilience, pour soi et pour son équipe. Et accepter nos vulnérabilités, c’est ce qui nous permet de continuer à soigner avec humanité
Bibliographie
Santos, L. C. P., McArthur, M., Perkins, N., & Goodwin, W. (2024). Psychological, physical, and professional impact on second victims in veterinary anaesthesia: a cross-sectional international survey – Part 1. Veterinary anaesthesia and analgesia, S1467-2987(24)00333-7. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.vaa.2024.10.140
Kogan, L. R., Low, R., Baldwin, J., & Brown, E. (2024). Personal resilience, good leadership, and a psychologically safe culture play a mitigating role on the impact of patient safety events. Journal of the American Veterinary Medical Association, 1–11. Advance online publication. https://doi.org/10.2460/javma.24.09.0620
ASSAGHIR, L. (2023). Les erreurs médicales dans la pratique vétérinaire animaux de compagnie. Thèse de doctorat vétérinaire. Nantes : école nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation Nantes-Atlantique.
Scott SD, et al (2009) The natural history of recovery for the health care provider « second victim » after adverse patient events. Qual Saf Health Care 18 : 325-30
Pour aller plus loin
Comment aborder ces sujets sensibles en équipe sans tabou ?
Le jeu TOUTOURISK a été conçu pour ouvrir la discussion sur les erreurs, les émotions et les facteurs humains. Grâce à ses cartes thématiques (écarts, conséquences, facteurs aggravants, limites humaines…), il permet d’identifier ensemble ce qui rend certains événements particulièrement marquants, et d’en tirer des pistes d’amélioration.
👉 Découvrez-le dès maintenant sur www.toutourisk.com et mettez l’humain au cœur de vos conversations d’équipe.