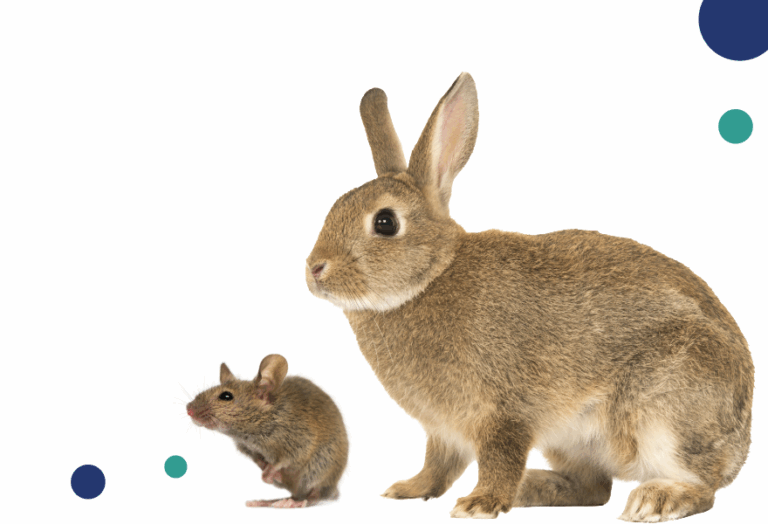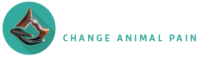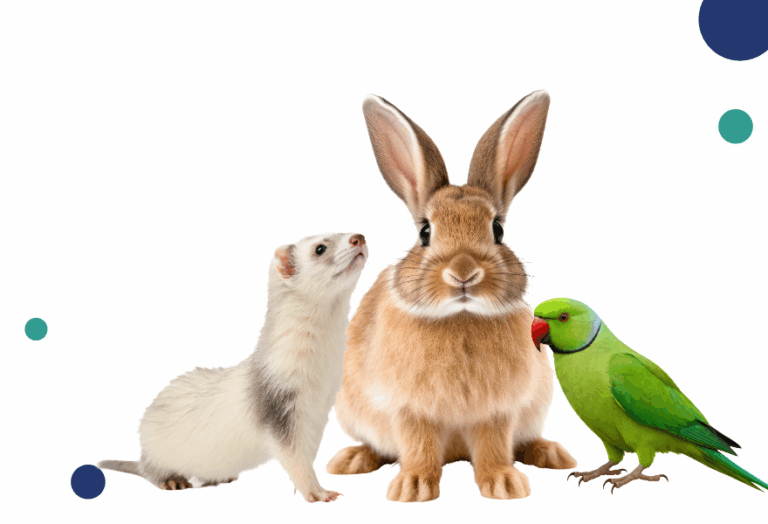Rééducation, physiothérapie,
et gestion médicale de la douleur
chez les petits mammifères
Références article :
Elizabeth Hyde¹, Rae Porter-Blackwell¹, Eva Bogner², ¹The Center for Bird and Exotic Animal Medicine, Bothell, WA, USA, ²Aiken Pet Fitness & Rehabilitation, Aiken, SC, USA
Résumé réalisé par le Dr Vet. Charly Pignon pour CAPdouleur – Octobre 2025
Résumé
La rééducation est un ensemble d’interventions destinées à optimiser les fonctions et à réduire le handicap chez les individus ayant des problèmes de santé. De nombreux patients peuvent bénéficier de pratiques de rééducation, et pas seulement ceux qui se récupèrent d’une blessure. Les patients en convalescence postopératoire, souffrant de certaines maladies, ou qui voient leur fonction décliner avec l’âge peuvent aussi en tirer un grand profit.
Malheureusement, la formation à la rééducation et aux techniques de gestion de la douleur non chimique pendant les études vétérinaires est limitée, en particulier chez les NAC. De plus, nos patients ont peu d’accès à la rééducation classique. Cette présentation offre une formation aux praticiens débutants ou expérimentés pour discuter et mettre en œuvre la rééducation chez les petits mammifères.
Cette Masterclass est structurée autour de trois axes : la rééducation, les traitements complémentaires de la douleur, et la gestion des complications chez les patients immobiles. Les thèmes abordés incluront la manipulation manuelle, la thermothérapie, la photobiomodulation, l’acupuncture et les champs électromagnétiques pulsés ciblés (tPEMF). La gestion des patients immobiles inclura la prévention des escarres et le soin des plaies. Tout au long de la présentation, nous partagerons des conseils et techniques fondés sur l’expérience et des preuves pour mettre en pratique la rééducation et utiliser des alternatives non pharmaceutiques pour la gestion de la douleur.
Partie 1 : Rééducation
Amplitude de mouvement
La physiothérapie se décline en plusieurs approches selon le problème traité. Pour les fractures, elle peut débuter dès que les os sont stabilisés. En cas de diminution de mobilité ou de maladie, elle sert à prévenir la perte musculaire. L’objectif est toujours de préserver ou de restaurer la fonction biologique normale du patient, avec une amplitude de mouvement et une flexibilité musculaire complètes.
L’amplitude de mouvement se divise en deux catégories : amplitude passive (Passive Range Of Motion = PROM) et amplitude active (Active Range Of Motion = AROM) au niveau de l’articulation. La PROM est très utilisée et peut être réalisée à domicile par le propriétaire. Ses bénéfices incluent la prévention des contractures articulaires et musculaires, l’augmentation du flux sanguin et lymphatique, et celle du liquide synovial afin de ralentir la dégradation du cartilage articulaire. L’évaluation de la progression doit débuter par une mesure de l’amplitude avec un goniomètre.
Pour réaliser la PROM :
- Stabiliser : immobiliser l’articulation proximale.
- Mobiliser : aller en flexion/extension.
- Maintenir : tenir 10-15 s.
- Relâcher : revenir lentement à la position de repos.
- Répéter : 10-15 répétitions par session.
Si le patient le permet, effectuer 2-3 fois/jour. Ce protocole vise à retrouver l’amplitude complète et limiter les séquelles de mobilité. Attention, le mouvement d’une articulation dépend parfois d’une autre (ex : la flexion complète du tarse est impossible en extension complète du grasset). On peut aussi mobiliser le membre dans un mouvement exagéré de type « bicyclette », ce qui sert de transition vers l’AROM.
L’AROM s’effectue avec plus ou moins d’assistance selon la force et la fonctionnalité de l’animal. Au début, le patient est soutenu par des liens ou par le thérapeute, puis, en progressant, l’assistance diminue et les exercices sont adaptés pour accroître force et proprioception.
Étirements
Les étirements sont souvent associés à la PROM, mais visent les muscles, tissus périarticulaires et tendons, évaluant la souplesse tissulaire. La flexibilité se teste dans le sens opposé à la fonction musculaire (ex : le biceps étend l’épaule et fléchit le coude ; on testera la flexion de l’épaule et l’extension du coude).
Sensation de mouvement articulaire
C’est la sensation obtenue en bout d’amplitude passive, classée en osseux, tissus mous, articulaire, bloc élastique (cf. Tableau). Ces informations orientent le plan de rééducation.


Tableau 1 : Caractéristiques des sensations de mouvement articulaire
Nom | Description | Exemple |
Osseux | Arrêt franc par contact osseux | Arthrose terminale |
Tissus mou | Blocage par les tissus mous | Flexion normale du grasset |
Articulaire | Arrêt ferme par capsule/ligaments | Extension normale du carpe |
Bloc élastique | Rebond, anormal (épanchement, souris articulaire) | Ménisque interne coincé |
Absent | Absence de résistance, pas de blocage (douleur du patient) | Fracture, sciatique |
Mobilisations articulaires
Le choix dépend de la douleur et de la raideur :
- Si la douleur prédomine, elle limite l’amplitude ou provoque un refus (sensation de « vide »). Il faut alors traiter la douleur d’abord, puis récupérer l’amplitude.
- Si la raideur prédomine, la douleur apparaît en fin d’amplitude après la résistance.
- Si douleur et raideur sont présentes, elles surviennent ensemble lors de la mobilisation.
Les grades de mobilisation sont :
- Grade I : petit mouvement dans le premier quart ; utilisé pour les articulations très douloureuses.
- Grade II : amplitude plus large, jusqu’au milieu de l’amplitude puis retour.
- Grade III : mouvement grand, jusqu’à la fin de l’amplitude et retour au milieu, pour gagner de l’amplitude.
- Grade IV : mouvement jusqu’à la fin puis petites oscillations ; augmente l’amplitude.
Massage
Pour les lésions tissulaires sans fracture ni plaie ouverte, le massage peut stimuler drainage lymphatique, circulation et mobilisation des tissus mous. Techniques : effleurage, pétrissage, points de pression. L’effleurage consiste à glisser les mains de la partie proximale (ou crânial) vers la partie distale (ou caudale) avec une pression moyenne. Le pétrissage relève d’un mouvement de roulement/pétrissage pour la relaxation et la circulation. La technique des points de pression cible les zones de contracture musculaire locale (compression 20 s puis relâchement 10 s). Ces techniques relaxent les muscles et favorisent la prise en charge de la douleur.
Exercices ciblés
Une fois l’amplitude fonctionnelle acquise, des exercices ciblés aident à restaurer la force, la mobilité et la proprioception. Le type d’exercice dépend de la pathologie ; la progression dépend du patient et ne doit pas être précipitée pour éviter rechutes ou douleurs.
Position assise/debout assistée
Tenir le patient assis ou debout sur un tapis antidérapant, par séances de 15-20 minutes, favorise la régénération musculaire et la perception de l’équilibre. Au fur et à mesure, le soutien se réduit, et l’on introduit diverses textures de sol pour s’adapter à l’environnement domestique.
Thérapie d’équilibre
Une fois debout, il faut travailler l’équilibre et la proprioception (poids déplacé doucement dans toutes les directions, dont le membre atteint). Dès que le patient accepte l’appui, on complique avec une planche d’équilibre.
Marche/exercice
Une fois l’équilibre maîtrisé, on reprend l’activité graduellement. Chez les chiens, on commence par des marches lentes en laisse. Chez les petits mammifères, augmenter la taille de la cage sur 3 à 6 semaines peut recréer ce contexte. On peut aussi utiliser des obstacles de type serviettes froissées.
Thérapie thermique
La cryothérapie (froid) réduit inflammation, douleur et œdème en phase aiguë (dans les 72 h), sur 15-20 minutes maximum. À appliquer après les exercices, jamais avant manipulation pour éviter une réponse douloureuse masquée. La thermothérapie (chaleur) augmente le débit sanguin, la relaxation musculaire, la souplesse des tissus et réduit la raideur, surtout après 72 h, pour 30-45 min, avant la manipulation.
Partie 2 : Traitements complémentaires de la douleur
Acupuncture
L’acupuncture vétérinaire, issue de la médecine traditionnelle chinoise, vise à rétablir l’équilibre du Qi et des forces Yin/Yang. En stimulant des points précis (acupuncture sèche, aquapuncture, électro acupuncture), on cherche à rééquilibrer le corps et à induire une action antalgique durable grâce à divers mécanismes neuro-hormonaux.
Photobiomodulation (thérapie laser)
La thérapie laser non ablative stimule la régénération cellulaire, la synthèse de collagène et les défenses immunitaires, tout en réduisant inflammation et douleur. Les protocoles varient selon la profondeur (2-6 J/cm² pour le superficiel, 6-10 J/cm² pour profond). Ne pas utiliser en cas de néoplasie, ni sur pansement, du fait de la pénétration directe nécessaire.
Champs électromagnétiques pulsés ciblés (Targeted Pulse ElectroMagnetic Field = tPEMF)
Le tPEMF applique un champ magnétique basse fréquence pour stimuler l’anti-inflammation et la production d’oxyde nitrique (NO) endogène, favorisant le débit sanguin et la cicatrisation. Ce signal traverse les pansements, mais il existe des contre-indications (comme la présence d’un pacemaker). Chez le chien, des études montrent des bénéfices postopératoires (diminution de la douleur, meilleure récupération neurologique). Les données sont limitées chez les NAC.
Compléments alimentaires
- Glucosamine : accélère la cicatrisation tendon-os (preuve en laboratoire chez le lapin), posologie variable selon espèce.
- Chondroïtine : cible le cartilage articulaire, effet cumulatif à long terme.
- Oméga-3 : réduisent l’inflammation. Des résultats prometteurs ont été décrits dans des conditions expérimentales chez le rat, la souris, et le lapin.
- Fortetropin® (MYOS) : myostatine, formulation à base de jaune d’œuf, réduit la fonte musculaire (preuve d’efficacité chez chien, chat, cheval ; données en cours chez les NAC).
Partie 3 : Gestion des patients non ambulatoires et de leurs complications
Soins des patients en décubitus
La prise en charge inclut l’adaptation de l’environnement (susbstrat appropriée, hygiène), la prévention des escarres et des brûlures urinaires/fécales, la stimulation mentale/nutritionnelle.
Soins de l’environnement
Trois couches : base (protection osseuse, ex : matelas à alvéoles, orthopédiques), contrôle de l’humidité (alèses, couches chiot), et une couche protectrice (serviettes, draps).
Même ces couches, les escarres peuvent apparaître ; il faut repositionner régulièrement le patient (tous les 2 à 6 h) et utiliser des coussins de soutien.
Soins de la peau
Pour les patients incontinents, une alternance de positions et des toilettages réguliers (tonte, shampoings secs ou doux) sont essentiels. L’utilisation de sprays barrières type 3M Cavilon protège la peau des irritants. Un suivi poids quotidien est essentiel, avec aménagement de la cage pour rapprocher l’alimentation afin que l’animal puisse se nourrir de manière autonome.
Stimulation mentale et activité assistée
La privation d’activité entraîne de l’ennui. Quand possible, la marche assistée ou l’utilisation de jouets et d’interaction permet de stimuler les patients.
Soutien nutritionnel
Chez les patients peu mobiles, le risque est l’insuffisance calorique ou la carence en fibres (risque de ralentissement du transit). L’alimentation doit être surveillée et adaptée, y compris via une réalimentation à la seringue et ajout de suppléments nutritionnel (par exemple, inhibiteurs de la myostatine pour lutter contre l’atrophie musculaire (effet non prouvé chez les NAC).
Prise en charge des plaies
La prévention reste la meilleure gestion des escarres, mais en cas de plaie, une évaluation de son stade et un traitement approprié sont nécessaires.
Tableau 3 : Stades des escarres (inspiré de la médecine humaine)
Stade | Description | Traitement |
I | Érythème non blanchissant, épiderme intact, pas d’ulcération | Détersion, cicatrisation par seconde intention |
II | Perte partielle d’épiderme et/ou derme, présence ou non de tissu nécrosé, ulcération, abrasion ou phlyctène | Détersion, cicatrisation par seconde intention |
III | Perte complète avec atteinte ou nécrose du tissu sous-cutané, ulcération profonde | Détersion chirurgical, reconstruction |
IV | Extension à muscle/os/tissus conjonctifs, nécrose, décollement | Détersion chirurgical, reconstruction |
La plaie doit être nettoyée soigneusement (NaCl sous pression), en évitant les antiseptiques agressifs pour ne pas ralentir la cicatrisation (comme par exemple la chlorhexidine, les produits iodés, la sulfadiazine argentique). Les alternatives incluent la polyhexanide, l’octénidine, et le miel.
Tableaux des pansements recommandés selon le type de plaie
Type de plaie | Exsudat | Type de pansement | Exemple | Fréquence de changement |
Mineure/épithélialisée | Aucun | Film | Tegaderm, Bioguard | Quotidien |
Brûlures/escarres | Peu | Hydrogel | Medihoney hydrogel, Aquaform | <3 jours |
Avant granulation | Modéré | Hydrocolloïde | Medihoney, Duoderm | 1–7 jours |
Escarres | Modéré | Mousse | Kendall AMD, Therahoney | 1–3 jours |
Brûlures/cavités, exsudat important | Abondant | Alginate | Medihoney, JorVet silver alginate | 1–7 jours |
Un pansement adéquat favorise la cicatrisation en maîtrisant le micro-environnement. Une antibiothérapie topique ou systémique peut être nécessaire pour les plaies infectées ou complexes. Pour les douleurs sévères, l’adjonction locale de kétamine (antagoniste NMDA) dans un hydrogel peut réduire le recours aux antalgiques systémiques (données issues surtout de la médecine humaine et de modèles animaux).
Références
- Koh RB, Rychel J, Fry L. Physical rehabilitation in zoological companion animals. Vet Clin North Am Exot Anim Pract. 2023;26(1):281-308. doi:10.1016/j.cvex.2022.07.009.
- Millis DL, Levine D. Canine Rehabilitation and Physical Therapy. Vol 2. Elsevier/Saunders; 2014.
- Gaynor JS, Muir WW. Handbook of Veterinary Pain Management. Elsevier/Mosby; 2015.
- Koh RB, Harrison TM. Acupuncture in zoological companion animals. Vet Clin North Am Exot Anim Pract. 2023;26(1):257-280. doi:10.1016/j.cvex.2022.07.008.
- Winkler CJ, Miller LA. Laser Therapy in Veterinary Medicine: Photobiomodulation. John Wiley & Sons, Inc.; 2025.
- Zidan N, Fenn J, Griffith E, Early PJ, Mariani CL, Muana KR, Guevar J, Olby NJ. The effect of electromagnetic fields on post-operative pain and locomotor recovery in dogs with acute, severe thoracolumbar intervertebral disc extrusion: a randomized placebo-controlled, prospective clinical trial. J Neurotrauma. 2018;35(15):1726-1736. doi:10.1089/neu.2017.5485.
- Alvarez LX, McCue J, Lam NK, Askin G, Fox PR. Effect of targeted pulsed electromagnetic field therapy on canine postoperative hemilaminectomy: a double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial. J Am Anim Hosp Assoc. 2019;55:283-91. doi:10.5326/JAAHA-MS-6798.
- Neil KM, Caron JP, Orth MW. The role of glucosamine and chondroitin sulfate in treatment for and prevention of osteoarthritis in animals. J Am Vet Med Assoc. 2005;226(7):1079-1088.
- Takesen A, et al. Glucosamine-chondroitin sulphate accelerates tendon-to-bone healing in rabbits. Jt Dis Relat Surg. 2015;26:277-83.
- Roush JK, et al. Multicenter veterinary practice assessment of the effects of omega-3 fatty acids on osteoarthritis in dogs. J Am Vet Med Assoc. 2010;236:159-66.
- Habeeb AA, et al. Role of omega-3 in the improvement of productive and reproductive performance of New Zealand white female rabbits. J Biol Rhythms. 2021;52(2):206-217.
- White DA, Harkin KR, Roush JK, Renberg WC, Biller D. Fortetropin inhibits disuse muscle atrophy in dogs after tibial plateau leveling osteotomy. PLoS One. 2020;15(4):e0231306. doi:10.1371/journal.pone.0231306.
- Saker K, Nettifee J, Stevenson M. Gastrointestinal and hematological tolerance of a muscle powder supplement in cats with chronic kidney disease [poster presentation]. Philadelphia, PA: AAVN Clinical Nutrition and Research Symposium; 2023.
- Haskey E. Nursing the recumbent patient. In Pract. 2020;42(5):268-278.
- Mickelson MA, Mans C, Sara A. Colopy. Principles of wound management and wound healing in exotic pets. Vet Clin North Am Exot Anim Pract. 2016;19(1):33-53.
- Hanks J, Spodnick G. Wound healing in the veterinary rehabilitation patient. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2005;35(6):1453-1471.
- Aisa J, Parlier M. Local wound management: a review of modern techniques and products. Vet Dermatol. 2022;33(5):463-478.
- Dabiri G, Damstetter E, Phillips T. Choosing a wound dressing based on common wound characteristics. Adv Wound Care (New Rochelle). 2016;5(1):32-41.
- Buote, Nicole J. Wound dressings. Techniques in Small Animal Wound Management. 2024:127-154.
- Skavinski KA. Opioid-sparing effects of topical ketamine in treating severe pain from decubitus ulcers. J Pain Palliat Care Pharmacother. 2018;32(2):170-174.
- Taqa GA. Evaluation of antinociceptive activity of ketamine cream in rats. Human and Veterinary Medicine. 2014;6(3):100-104.
Découvrir plus d'articles